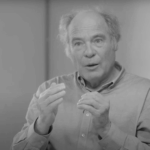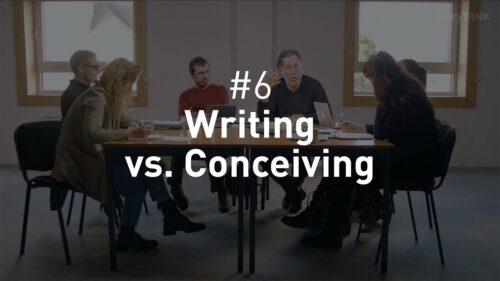Saison 1
La SAISON 1 tente de répondre aux questions suivantes à travers ses sessions de réflexion :
Comment et pourquoi le spectateur plonge-t-il dans une histoire ?
Les histoires peuvent-elles nous transformer ?
Comment fonctionnent les récits ?
Comment les scénaristes travaillent-ils et conçoivent-ils ? Les êtres humains ont-ils besoin d’histoires ? Quels types d’histoires nous aident dans la vie quotidienne?
Comment la narration produit-elle du sens ?
Est-il possible de créer de nouveaux modèles narratifs ?

À propos
PHYSIOLOGIE DU SPECTATEUR
Concevoir un récit fictionnel exige généralement des auteurs et des scénaristes qu’ils entretiennent une relation paradoxale entre la notion de spectateur-récepteur, à la fois source de motivation et de contrainte. Bien que le récepteur soit au cœur du mécanisme narratif, une approche moins essentielle serait parfois préférable en raison des implications liées au seul marketing. Cette relation paradoxale constitue un obstacle à la construction d’un socle commun de compréhension de l’expérience du spectateur d’un point de vue pratique.
Ayant à l’esprit l’idée de faciliter l’émergence de ce noyau de compréhension pertinent pour la communauté des auteurs de fiction, cette première session inédite de StoryTANK impliquera une rencontre entre des scénaristes dotés de compétences pratiques, et des chercheurs ou experts, porteurs d’une expertise spécifique dans des domaines clés de réflexion :
Description de l’expérience neuropsychologique et physiologique d’une immersion dans un film de fiction.
Quel type d’activité cela implique-t-il ? Quels sont les mécanismes ou réflexes physiologiques impliqués ? Quelles sont les conditions de réussite ? Dans quelles circonstances l’immersion échoue-t-elle ? Ces conditions sont-elles universelles ?
Les motivations du spectateur : qu’attend-il de cette expérience ? Quels types de besoins de satisfaction conscients recherche-t-il principalement ? Quelles sont ses attentes moins conscientes ?
Les émotions impliquées dans cette expérience immersive. Le lien entre ces émotions et les dimensions pragmatiques du récit.
S’attend-on à vivre des émotions familières ou inédites ? À se divertir ou à approfondir sa découverte de soi à travers l’expérience fictionnelle ? Les récits cinématographiques répondent-ils à des besoins émotionnels spécifiques ? Le phénomène central de l’empathie trouve-t-il son origine dans une expérience émotionnelle ?
Les conditions d’émergence du sens d’une expérience émotionnelle .
Quel rôle joue le jugement moral dans l’expérience du spectateur ? Est-ce un facteur clé ? De quelle manière l’émergence du sens dépend-elle de la construction d’une métaphore par le spectateur ?
Chacun de ces thèmes sera abordé à travers des discussions portant sur notre préoccupation principale : de quelle manière l’expertise scientifique peut-elle soutenir ou contredire les capacités intuitives des scénaristes et comment peut-elle enrichir leurs méthodes d’écriture ? Dans quelle mesure remet-elle en cause les théories et les hypothèses établies dans le domaine de l’écriture scénaristique ?
DYNAMIQUE DE LA CRÉATIVITÉ DANS L’ÉCRITURE DE SCÉNARIOS
Depuis les années 1980 et la « crise du scénario » en Europe , les scénaristes disposent d’un ensemble de méthodes et de modèles théoriques pour organiser et structurer leur travail. Mais qu’en est-il de l’originalité des idées elles-mêmes et de leur singularité ? Comment faciliter la créativité des auteurs pour les encourager à sortir des sentiers battus, à oser explorer de nouveaux territoires ou à les explorer autrement ?
La notion même de créativité fait l’objet d’études et d’analyses scientifiques depuis plusieurs décennies. Le processus créatif et ses différentes étapes sont désormais connus. Pourtant, cette description précise des conditions d’innovation et d’émergence des idées a jusqu’à présent peu influencé les pratiques des scénaristes.
Ce deuxième volet du StoryTANK vise à initier des échanges entre scientifiques et scénaristes sur la genèse des idées, la nature du processus créatif narratif, les conditions et dispositifs nécessaires pour faciliter cette créativité.
Qu’est-ce qu’une idée nouvelle ? Comment est-elle obtenue ? Comment la reconnaît-on ?
Comment générer une multitude de possibilités pour éviter de se limiter à une idée initiale que l’on pense pouvoir avoir ? Certaines attitudes sont-elles plus créatives que d’autres ? Existe-t-il des méthodes ou des circonstances qui facilitent la génération de nouvelles idées ?
Quel est le processus de sélection des idées ?
Que se passe-t-il entre l’apparition d’une idée initiale et sa confrontation avec des idées concurrentes, voire complémentaires ? Et selon quel processus un ensemble d’idées peut-il conduire à une construction singulière ?
Dans quelle mesure le processus créatif à l’œuvre dans le storytelling est-il comparable à celui des disciplines scientifiques ?
Comment ces concepts de créativité contemporains se comparent-ils au modèle d’apprentissage classique, qui va du concept à l’application, du général au particulier, du plan à la réalisation (mode descendant) ? Quels sont les avantages d’une approche ascendante (du concret à la conceptualisation) ?
LA FONCTION ANTHROPOLOGIQUE D’UN RÉCIT FICTIONNEL AU XXIe SIÈCLE
Dans nos sociétés actuelles, les récits fictionnels (films ou séries) sont généralement classés dans la catégorie « divertissement ». Pour divertir, à des fins récréatives. Comme si leur importance anthropologique équivalait à une partie de flipper. Et pourtant, ce sont ces récits fictionnels, déterminés par l’image, qui forgent nos émotions, nos représentations du monde, nos projections .
Parallèlement, une tendance fondamentale prévaut depuis les années 1960 parmi les auteurs européens (théâtre, cinéma, romans, etc.) : elle tend à déprécier la notion même de narration. Comme si le populisme était inhérent à la construction narrative, voire dégradant. Quelles sont les conséquences de ce déclin du récit en Europe ?
À l’inverse, outre-Atlantique, depuis « Star Wars », les récits hollywoodiens se sont structurellement standardisés, industrialisés, généralisant le paradigme narratif et les caractéristiques des super-héros. Quelles sont les conséquences actuelles ou prévisibles de cette évolution ?
Ces différences entre l’Europe et les États-Unis peuvent paraître anecdotiques si l’on considère que la narration est généralement perçue comme secondaire dans les rituels d’une société ou d’une culture. Est-ce vrai ? Quel rôle joue précisément le « divertissement » dans la société actuelle ?
Dans leur travail, nourris de leur sensibilité et de leur jugement personnels, les scénaristes ignorent souvent leur rôle anthropologique ou sociétal, leur appartenance géographique (ou non) ou leur interprétation du monde dans lequel nous vivons.
De quelle manière pouvons-nous les aider à mieux comprendre les conséquences de ce qu’ils cherchent à développer ?
Dans ce troisième volet, les chercheurs participants partageront leurs hypothèses sur la nature de la fonction anthropologique du récit. Par exemple, pour Johan Braeckman, philosophe flamand, le récit fictionnel est une sorte de « simulateur de vol » qui nous prépare aux interactions avec nos semblables, avec le monde extérieur, ses transformations et ses dangers.
A partir de ce thème central, d’autres questions plus spécifiques peuvent être abordées sur l’impact moral et collectif des récits, la prise en compte des différences culturelles des publics, les moyens du récit, qu’il soit de nature orale ou écrite.