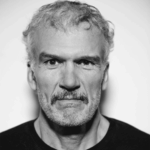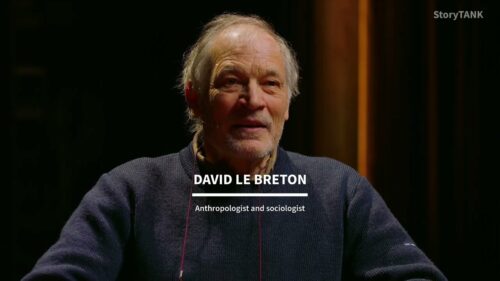Des récits pour soigner ?
Alors que les récits d’un monde en crise nous heurtent, comment ne pas sombrer dans la folie ? Comment penser les récits d’un retissage, d’une construction individuelle et collective ?
Avec Julie Budtz Sørensen – scénariste (Danemark), Tamara Russell – spécialiste des neurosciences et des arts martiaux (Royaume-Uni), Roberto Beneduce – ethnopsychiatrie et anthropologue (Italie), ainsi que Mathilde Delespine – sage-femme, coordinatrice de la Maison des femmes Gisèle Halimi du CHU de Rennes.
— une conférence enregistrée aux Champs Libres (Rennes) en décembre 2023 dans le cadre de la série “Quels récits pour notre temps ?”, animée par Nicolás Buenaventura – auteur-réalisateur et conteur – et Yann Apperry – scénariste, dramaturge et romancier.

Tamara Russell
Du nous au je.
Ce qui me préoccupe en interagissant avec le monde, à travers le prisme qui est le mien – celui des neurosciences et des arts martiaux -, est d’analyser la nature même d’une histoire. Est-ce une pensée ? Un mouvement ? Puis de le qualifier : est-ce un mouvement mental, fruit de l’imagination ? Un mouvement du cœur qui nous inspire, par le sentiment et la sensation ? Ainsi que d’analyser le rôle du corps et des mouvements physiques comme parties intégrantes de la conception d’une histoire.
Dans quelle mesure l’état du monde — la psychose ou même la folie collective comme certains le qualifie — dans lequel nous sommes piégés et coincés, nous habite, en tant qu’individus ?
Avant d’élaborer des histoires collectives, il y a une responsabilité personnelle à d’abord examiner nos propres histoires en tant qu’individus.
Le “nous” est porteur des blessures, douleurs et préjugés du “je”.
Concernant le processus de guérison – ce que les arts martiaux m’ont appris -, nous pouvons, chacun, faire beaucoup pour notre propre guérison, si nous sommes capables de ressentir nos propres blessures, qu’elles soient physiques, psychologiques ou mentales.
De l’intériorité à l’altérité.
Nous pouvons être toutes & tous chercheur·e·s et auteur·e·s de notre propre expérience, à travers la quête de la sensation, le toucher nous permettant d’entrer en contact avec nos propres blessures et douleurs. Une intériorité qui permet l’altérité. S’ouvrira ensuite cette porte pour être naturellement plus compatissant lorsque nous serons confrontés aux blessures et aux douleurs des autres, autour de nous.
Écouter pour donner un sens.
Quand nous écoutons, l’information entre dans notre cerveau, qui l’organise pour tenter d’en donner un sens. Le cerveau fait alors remonter autant d’expériences auxquelles nous pouvons nous connecter. Il trie pour comprendre : ai-je déjà eu une expérience de cela ? Puis-je m’y connecter d’une manière ou d’une autre ? Avec cette propension naturelle à essayer de donner un sens à cette information, en relation avec notre propre expérience. Rien de faux ou de mauvais. Mais le danger réside dans la conscience de cette réaction, que celle ou celui qui écoute a le pouvoir qui peut en découler, particulièrement si elle ou il est dans une position hiérarchique en thérapeute ou médecin.
L’écoute ouverte pour rester connecter.
Comment écouter sans diagnostiquer de manière préemptive ?
Comment rester dans l’ouverture dans le processus d’écoute ? Me concernant, la pratique de la pleine conscience, de la méditation a été essentielle pour me permettre de réguler cette anticipation qui stoppe l’altérité. Comment écouter comme le ferait un enfant ? Ce n’est pas se débarrasser de l’ensemble de notre expertise, mais la mettre de côté pour rester dans la connexion aussi longtemps que possible.
Le corps et les mots.
Le corps est, pour moi, un enseignant et un outil – particulièrement, quand les mots sont difficiles à trouver. Il est intéressant de se concentrer sur l’intention de faire un mouvement et d’essayer d’observer comment cette décision – prise par notre lobe frontal – prépare le corps à agir. Le cerveau fait, alors remonter les expériences passées et code toutes les informations sur la façon de réaliser le mouvement préciser, avant de l’envoyer au corps.
Références et potentialités.
Comment puis-je faire un mouvement que je n’ai jamais fait auparavant ? On active, alors, au niveau du cerveau “la liberté de ne pas vouloir”. Il ne s’agit pas de libre arbitre. Il s’agit de lâcher prise pour créer l’espace de la potentialité. Comme pour un bébé qui commence à explorer le monde. Il n’a pas encore le mouvement de la marche. Il essaie alors toutes les différentes adaptations de placement du pied, de hanche et de tête, avec une concentration focalisée. Et lentement, un mouvement automatique naît, qui peut être fait, sans conscience. Mais pouvons-nous, en tant qu’adultes, pratiquer la marche comme si nous marchions pour la première fois ? Intention, attention, conscience, sentir le monde, marche consciente.
Automatismes et premières fois.
Quand nous rencontrons quelqu’un pour la première fois, notre cerveau n’a également aucune référence passée. Nous sommes bloqués et nous remplissons le vide avec toutes les pré-conceptions et préjugés possibles. C’est un moment unique où bouger ensemble : se suivre, refléter, en activant les neurones miroirs du cerveau qui composent un réseau social d’empathie avec le sentiment de lien et d’appartenance.
Le respect de l’appropriation du récit.
Le respect est fondamental et la conception du récit doit garantir une certaine sécurisation des personnes et même des personnages et de leurs interprètes.
Comment exposer les expériences ? À travers une œuvre d’art, à travers la narration. En fonction de l’appartenance et des cultures. Nous devons reconnaître que la peur vécue en République démocratique du Congo peut être différente de la peur vécue par une personne cheminant dans les rues de New York. La peur, dans le cerveau, est une constellation très particulière de réseaux neuronaux qui s’activent de certaines manières lorsque le cortisol inonde le cerveau.
Mettre en sécurité pour ouvrir les consciences.
Je peux me sentir en sécurité avec vous. Pourquoi ? Comment créer des espaces sûrs et sécurisés, propices à permettre d’étirer le réseau de saillances du cerveau qui sont amenées par différentes tonalités et nuances. Pour ouvrir les consciences. Sans coup de poing, sans violence choquante ou autre, gore. Manier l’implicite et le subtil pour être ensemble, dans un déploiement collectif du récit.
Les micro-détails fondamentaux du récit.
L’impulsion et les boosts qui catalysent le récit sont dans les micro-moments de connexions, de sourires ou de gestes pour des micro-changements qui s’additionnent. Nous ne pouvons pas tout réparer, sauver le monde comme nous le pensons au début de notre carrière. Ce sont notamment des scènes précises, dans un scénario, avec la description de gestes, de remarques, comme des empreintes dans la globalité du récit qui activent le changement.

Roberto Beneduce
L’hégémonie linguistique : un danger de notre époque.
Je suis entré en résistance à la violence de la langue unique lorsque j’ai rencontré la folie, pour la première fois, en périphérie de Naples, ma ville natale. Je suis alors entré dans une forêt remarquable de langues et d’histoires. Une forêt de fous, des femmes et des hommes, pour la plupart très pauvres. Ils étaient obligés de parler d’eux-même dans le langage de la psychiatrie. La violence de l’hégémonie linguistique est un danger de notre époque. C’est ici, clairement, un exemple de terrorisme linguistique — contraignant ces personnes à réduire leurs expérience, leurs multiplicités de langages pour un langage dominant. J’ai alors commencé à remettre en question la relation entre la connaissance et l’expérience des autres.
Guérir l’autre : co-écrire.
Avant de questionner si les histoires, les mots peuvent guérir, posons une question essentielle : sommes-nous prêts à entendre les histoires des autres, d’autres manières de raconter le temps, l’expérience, nos corps… ?
Quand j’ai commencé à étudier l’anthropologie, pour mon doctorat, j’ai travaillé en Afrique de l’Ouest notamment avec des guérisseurs locaux, travaillant sur les troubles mentaux.
C’était une autre forêt de langages, de symboles, de stratégies, de mondes. J’étais ignorant et j’ai appris. Guérir l’autre n’est pas lui donner une vérité, mais co-écrire une vérité et co-imaginer une histoire.
Renouveler l’écoute, sans cesse.
L’expérience réalisée au cours de mes 28 dernières années auprès de migrants a été pour moi une autre révélation : j’ai été “obligé” de ré-imaginer la façon d’écouter leur vérité, leurs mensonges, leurs expériences.
Multiplier le langage.
Nous devons multiplier le langage, en incluant dans notre travail de cliniciens, de chercheurs, d’écrivains, de poètes : d’autres codes.
Les couleurs de nos mots.
Nous devons préalablement reconnaître les couleurs de nos mots. Hors, quand vous parlez de vous-même, en venant d’un autre pays, vous devez “lutter” inconsciemment contre vos propres couleurs. C’est un effort avec soi-même pour contrôler nos mots ainsi que pour contrôler nos yeux : notre regard peut être violent s’il est un regard puissant.
Le langage fragmenté.
Le langage des “sans-pouvoir” est caractérisé par sa fragilité ontologique, il est fragmenté.
Souvent, l’incompréhension naît de l’abondance de mots et d’histoires dans l’histoire. Et cette fragmentation et le manque de cohérence sont exacerbés quand les personnes sont en souffrance. Les personnes migrantes essaient de sauver toute leur vie dans une autre langue, obligés de traduire leurs corps, leurs gestes dans un autre monde. Le langage des personnes “sans pouvoir” est un langage timide. C’est un langage caractérisé par une sorte de “honte” et un langage hésitant. Même quand les gens crient avec agressivité, ils ont honte, car leur cri est un langage de désespoir.
Reconnaître les fragments de l’inconnu.
Un scénario qui veut restituer toute la richesse d’un individu doit reconnaître les fragments du langage, en ré-imaginant leurs places et leurs définitions. Les cris, le manque de cohérence sont peut-être des raccourcis pour un mythe, une perspective et une mémoire culturelle que nous ignorons complètement.
Le temps est le secret d’un récit réussi.
Entrer dans un autre monde nécessite du temps. Hors, une maladie de notre époque est le manque de temps pour écouter l’autre. Encore une fois, sommes-nous prêts ? C’est le défi. Chaque type d’histoire est une nouvelle architecture du temps, avec une suspension de ce temps. Les séries a son propre temps. Les rituels thérapeutiques opèrent avec la même logique, bloquant le temps. Dans ce temps contraint, on peut imaginer une autre expérience, un projet, attendre une autre histoire. Cette façon de travailler avec le temps est le secret de chaque thérapie réussie, de chaque récit réussi.
Vendeurs d’histoires.
Nous sommes face à la duplication des histoires, du storytelling avec la multiplication des vendeurs d’histoires : ces personnes dont la profession est de vendre contre de l’argent un récit au migrant avant qu’il ou elle ne se présente… Pour être crédible. Pour obtenir la protection humanitaire. Ce qui nous amène à re-considérer l’histoire, l’épopée, le récit, le roman…
La symbolique du prénom.
Dégeler les mots, détrivialiser les mots.
Considérer le prénom, focaliser sur ce prénom et écrire l’histoire de ce prénom.
Toucher le prénom : c’est toucher un secret, un danger, une règle, l’histoire d’une communauté, d’une famille, d’un village.
Les métaphores pour créer des ponts entre les temps et les lieux.
Travailler par métaphores permet de créer un code imaginatif qui permet de « connecter » : établir des ponts entre les temps et les lieux. Et les lieux ont des mémoires. Habituellement, nous parlons de notre corps, de notre individualité et, nous oublions la relation entre le corps et les espaces, les lieux que nous avons habités ou visités auparavant. Par exemple, j’échangeais avec une femme venant de République démocratique du Congo, du lac Goma qui était totalement bloquée et traumatisée après avoir été agressée sexuellement et violée. Quand je lui ai dit : « Je connais ce lac, je connais cette ville. Dans cette ville, vous préparez un très bon poisson. » Elle a souri. Elle a alors recommencé à imaginer une possibilité, pour son corps, de vivre dans ce monde, même si ce monde est un monde de violence, de mort, d’humiliation. C’est un travail continu de découvertes, pas à pas, où se placent les personnes/personnages, où nous nous plaçons, dans ce mouvement collectif.
Multiplier l’orientation sémiotique.
Quand les scénaristes esquisse un scénario : ils multiplient les signes et leurs sens possibles pour ne pas partager aux gens une histoire complète. Ils donnent, alors, la possibilité de s’identifier dans cette forêt composée de la science de la sémiotique.
Le paradigme narratif dans la société.
Dans de nombreux cas, nous ne sommes pas prêts à écouter les expériences traumatiques émanant d’autres pays, d’autres régions du monde. Un de mes collègues venant d’Afrique m’a dit : “Vous, Européens, vous, Occidentaux, vous n’êtes pas prêts pour nos traumatismes.” Et je pense qu’il avait raison. Nous les regardons et traduisons, en quelque sorte, en termes médicaux, mais le problème reste invisible.
La question de rendre tout traumatisme explicite est importante. Nous vivons sous l’empire du paradigme narratif dans notre société : nous pensons que nous devons tout dire. Et ce n’est pas nécessaire. Le travail clinique, la recherche consiste à se placer à côté des choses, à côté d’une expérience et non, nécessairement de les expliciter, de les découper. C’est un travail chirurgical et non, un travail psychologique, psychotrope. Ce qui est important est de communiquer aux autres, notre disponibilité à écouter, prêts à aider.
Le récit collectif pour des métamorphoses individuelles.
Le récit pour réintégrer notre monde.
La première métamorphose qu’un récit doit impulser est de reconnecter l’individu à l’autre. Recréer un minimum de mémoire partagée et de lien. Le récit permet de ré-imaginer une micro-communauté entre une personne, un personnage seul – perturbé par son expérience, et le clinicien, le spectateur. Le récit permet de re-créer le premier échange minimal et la réintégration qui est constituée de la métamorphose d’être à nouveau dans un monde possible contre la fin du monde, contre le risque d’apocalypse.
Notre société connaît davantage l’anxiété de la méfiance. Les migrants sont venus ici et ils sont objet de suspicion et réciproquement, ils se méfient de notre monde. Comment pouvons-nous nous reconstruire, sans reconstruire un minimum de communauté ? Cette réintégration est la première étape d’une métamorphose.
Une histoire épique et non tragique.
Notre accompagnement envers les personnes humiliées est de faire une histoire épique de leur histoire tragique. Leur dire : “Vous n’êtes pas juste une victime. Vous n’êtes pas juste des personnes malades. Vous n’êtes pas juste désespérés”. Nous devons transformer, dans un sens épique, leurs trajectoires. Chaque thérapie doit réaliser cette métamorphose.
Nous pouvons introduire dans ces corps humiliés, blessés, honteux : un mot de grâce pour guérir. Nous devons introduire des petits miracles dans nos histoires.

Julie Budtz Sørensen
Intime et collectif.
En tant que scénariste travaillant pour le cinéma et surtout pour la télévision, j’essaie de trouver un pont entre les deux mondes : intime et collectif.
Lars von Trier – réalisateur danois – a déclaré un jour qu’un film devrait être comme un caillou dans la chaussure”. Hors, comment procéder dans l’industrie du divertissement qui, à bien des égards, veut obtenir ce qu’elle a déjà : dire quelque chose sur la société et à propos de certaines personnes que le spectateur n’a peut-être pas l’habitude de voir dans la fiction, à la télévision ou au cinéma.
L’empathie pour des personnages fictifs.
Une histoire que l’on souhaite raconter est le fruit d’un dialogue avec les producteurs et également les diffuseurs, pour trouver la forme, pour raconter l’histoire de manière appropriée.
Au Danemark, ils sont tous assez accros pour passer deux heures sur Netflix, chaque soir.
Vous suivez des personnages et vous vous engagez dans leurs vies. C’est une excellente opportunité d’apprendre quelque chose et de ressentir de l’empathie pour des personnages fictifs.
La remise en question des visions du monde.
Il y a le danger de l’effet inverse : devenir quasi antisocial, préférant le monde de la fiction à la réalité puisqu’il résonne avec la vision du monde que vous avez déjà. Il n’y a aujourd’hui que trop peu de remise en question de cette vision du monde du spectateur.
Une grammaire commune pour un langage commun ?
En travaillant en groupe, il y a une certaine grammaire avec laquelle il est difficile de ne pas travailler. Nous travaillons dans des salles d’écriture où nous devons avoir un langage commun. On nous enseigne à l’école, une grammaire qui remonte à Aristote et également à la tradition américaine : comment raconter une histoire dans un film, les points de basculement et de non-retour… Des process qui sont sont bons pour les ébauches, mais s’ils deviennent déterminants pour l’histoire et si on commence par là, alors, on sait de suite où va l’histoire. C’est un confort pour le spectateur de regarder une histoire dont il sait où elle va.
Passer “sous la peau” du personnage.
Se connecter avec quelqu’un est aussi un enjeu d’émotions. En travaillant sur des séries télévisées de longue durée, on a la possibilité de suivre un personnage sur un temps long et de passer en quelque sorte, sous sa peau, dans sa tête. Le défi réside dans la présentation de nouveaux personnages embarquant, avec eux, un bagage de nouvelles histoires. Le spectateur doit se projeter à passer du temps avec eux et, espérons-le, de passer sous leurs peaux.
Multiplier les angles pour un même personnage.
Ainsi, pour raconter une histoire, il peut être utile de recourir à des astuces comme les cliffhangers et le suspense pour, en quelque sorte, “manipuler” le spectateur – afin qu’il s’engage dans la connexion. Sans moralisation. Ce qui n’est pas simple comme exercice pour moi qui écris, mais également pour les spectateurs. Voir le personnage sous différents angles est essentiel. Il est très satisfaisant de travailler pour un format de longue durée : on peut, alors, véritablement explorer différentes perspectives.
Re-créer collectivement un monde unique.
La raison pour laquelle je me suis lancé dans le cinéma est mon amour pour le travail collaboratif. On débute avec une certaine vision initiée qui sera, ensuite, remise en question par tant de personnes dans le processus. C’est un processus tellement long qu’il est collectif et ouvert, de l’idée à l’œuvre finie. Et même en finalisation, avec le montage notamment son, il se recrée encore le récit de l’histoire. Pour moi, l’une des étapes les plus agréables de la création est le montage. Pour un écrivain, le travail avec le monteur est une reconstruction de l’histoire écrite, avec de nouvelles contraintes post-tournage, à partir de l’essence du matériel disponible. S’active, alors, une nouvelle créativité.
L’addiction dans la narration.
Aujourd’hui, le binge-watching est plus que courant. Mais quel impact cela a-t-il réellement sur nous, de consommer autant et pourquoi en avons-nous besoin ? Et nous, scénaristes, serions ainsi comme des “dealers de drogues”.
Raconter le traumatisme.
J’ai composé le récit de tout un épisode sur un viol, le personnage principal était la meilleure amie de la victime. J’ai orienté le récit du point de vue donc du personnage principal. Raconter l’histoire de manière respectueuse est un enjeu et la méthode pour y arriver est un dilemme. La recherche avec des entretiens auprès de personnes ayant vécu ce que nous mettons en récit, dans la réalité, nous aide.

Mathilde Delespine
Le récit pour re-créer du lien.
Le récit pour un partage d’expériences.
Dans mon travail de sage-femme, j’aide les femmes enceintes à devenir mères, les couples à devenir parents. Notre travail – puisqu’il est totalement collectif – va également bien au-delà de la grossesse, dans un accompagnement pour la santé, plus largement jusqu’à une aide dans le cadre de violences – au niveau des droits juridiques et sociaux.
Nous créons également les liens avec d’autres femmes pour stimuler les rencontres, partager des expériences communes ou similaires, complémentaires.
Le récit pour une reconnaissance mutuelle.
Il est important de permettre la reconnaissance mutuelle, que chaque femme puisse se sentir comprise et s’identifier positivement à d’autres femmes.
Des corps et des esprits maltraités, à reconstruire.
Ces femmes portent en elles la honte de la violence qu’elles ont subie. Les corps sont souffrants, engourdis, dissociés : ces femmes sont déconnectées de leur corps. Nous tentons de créer une zone de sécurité et de confiance en nous adaptant énormément à chacune d’entre-elles.
En tant que professionnels de santé, dans un système actuel dysfonctionnel, nous pouvons également être déconnectés de nos corps. Nous pouvons négliger nos corps, négliger notre sommeil, notre santé.
Le récit pour résurrection.
Nous sommes face à des violences interpersonnelles et également des violences systémiques. La violence systémique est le non-accueil des personnes en exil qui fuient, comme nous fuirions ce qu’elles ont fui. Si nous avions subi ce qu’elles ont subi, sans doute choisirions-nous aussi de fuir, si nous avions leur courage. Il y a aussi des femmes nées ici qui subissent la violence du système, qui ne protège pas suffisamment les femmes victimes de violences, les enfants.
Nous ressentons et vivons beaucoup d’émotions puisque, parfois, nous partageons les leurs, leur colère, leur indignation…
Ces femmes ont besoin d’être ressuscitées : médicalement, socialement, juridiquement, et elles ont besoin d’être “boostées”. Ce qu’elles ont subi est tellement stupéfiant que c’est difficile à croire.
Le traumatisme détruit la représentation du monde.
Le traumatisme détruit notre représentation du monde et détruit le sens. C’est pourquoi c’est violent. C’est incompréhensible. Ceci ne devrait pas arriver à un être humain. Donc, parfois, nous voyons des femmes qui sont presque sans vie mais elles sont devant nous, vivantes. Elles font face. Mais quelque chose est mort.
La narration pour intégration.
Le système évoqué est contradictoire. Il faut s’intégrer à la vie française, il est demandé de parler français, mais les cours de français sont complets. Il faut être un réfugié utile, être très instruit, être utile à la société. Mais en tant que réfugié, vous n’avez pas le droit de travailler. La loi l’interdit. Uniquement du bénévolat possible.
Nous faisons ce que nous pouvons, du mieux que nous pouvons, avec un grand engagement, parce que ces femmes nous y obligent, par leur résistance. Les êtres humains sont extrêmement adaptables et, chaque jour, nous voyons des personnes qui résistent, qui se tiennent debout. Nous n’avons aucune idée comment. Donc bien sûr, elles nous motivent.
Résilience & espoir par la parole & le mouvement.
Nous co-animons des groupes de parole ou des ateliers thérapeutiques à travers le karaté, le théâtre, l’art-thérapie ou la danse. Nous tentons de passer du désespoir à l’espoir, des pleurs aux rires. C’est un fil de vie. Nous devons continuer à vivre malgré tout, malgré la violence et cela empêche cette violence de triompher.
La possibilité du récit, la force de l’écoute.
Permettre à ces femmes de raconter leur histoire, d’une manière ou d’une autre est précieux, au même titre que notre écoute. Nous essayons juste de les écouter, sans être simplement des professionnels de santé qui ne font que prescrire, ou des juristes qui ne donnent que des conseils, mais avant tout : véritablement écouter. Ce ne sont pas les mots de la victime de violence qui la libèrent, c’est notre capacité croissante à écouter.
Ouvrir le récit.
Nous sommes formés à poser des questions ouvertes. Nous demandons : comment allez-vous ? Plutôt que de dire : allez-vous mieux aujourd’hui, Madame ? Un simple exemple.
La mise en confiance pour libérer les mots.
L’histoire commence quand nous disons bonjour et avec l’attitude physique. Parfois, certaines femmes peuvent être très renfermées. Avec la moindre forme d’expression, l’histoire peut commencer. Le début ? Certaines femmes disent : “Avec ce bébé, je veux recommencer ma vie. Je n’accepterai plus ce que j’ai enduré jusqu’à maintenant. J’ai accepté cela mais pour ce bébé…” Et on perçoit l’initiation d’une nouvelle histoire.
Bifurquer pour initier une nouvelle histoire.
La période périnatale est cruciale parce que nous savons que les traumatismes, les violences peuvent se répéter d’une génération à l’autre. En essayant de créer cette relation de qualité avec elles, de les aider à sentir qu’elles le méritent : nous permettons à ces femmes de bifurquer vers un chemin de sécurité. Pour commencer une nouvelle histoire – qui n’effacera pas leur passé, ce qu’elles ont enduré – qui impulsera une nouvelle façon de se rapporter aux autres, une capacité d’agir, sans soumission ni domination. Sans être abandonnées. C’est pourquoi nous devons accoucher, ensemble.
Le récit : une graine à faire germer.
La rencontre est importante puis la patience. C’est comme semer une graine, parfois elle germe immédiatement parce que le sol est prêt. Parfois non. Vous préparez le sol et ce pourrait être un collègue ou un compagnon ou une campagne attentionnée ou un·e ami·e qui sèmera la graine. La jardinière principale est cette femme qui a besoin de se reconstruire. Nous sommes là, juste pour l’aider.