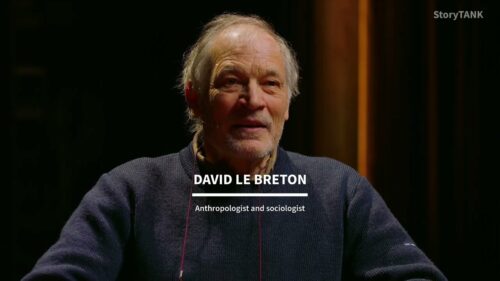Création de récits : l’affaire de tous ?
Les neurosciences éclairent sous un jour nouveau le mythe du génie créateur.
Serions-nous tous capables de provoquer des torrents de mondes imaginaires et de récits ébouriffants ?
Avec Jan Schomburg – Scénariste & Réalisateur (Allemagne), Samah Karaki – Chercheuse en neurosciences (Liban & France) et Tamara Russell – Spécialiste des neurosciences et des arts martiaux (Royaume-Uni) ainsi que Thomas Roze (France) – Ostéopathe et témoin de la table ronde.
— une conférence enregistrée aux Champs Libres (Rennes) en décembre 2023 dans le cadre de la série “Quels récits pour notre temps ?”, animée par Nicolás Buenaventura – auteur-réalisateur et conteur – et Yann Apperry – scénariste, dramaturge et romancier.

Samah Karaki
« Ouvrez le récit à la pensée que vous ne comprenez pas. »
Automatiser pour nous libérer.
En ce moment même, nous, sans en être conscients : nous respirons, par exemple, et nous accomplissons un grand nombre d’actions automatiques qui constituent des mécanismes physiologiques.
Nous sommes sur le point de mourir, puis nous respirons et nous sommes, de nouveau, en vie. Nous agissons en nous appuyant sur notre système nerveux autonome qui nous indique, chaque semaine : je m’occupe de digérer votre nourriture, de maintenir votre température corporelle et de combattre tout germe étranger qui pénètre dans votre corps afin que vous puissiez – actuellement – participer à cette table ronde. Nous sommes ainsi, toutes et tous, disponibles pour faire autre chose. Notre système exécutif n’est pas conscient : non préoccupé par tous ces problèmes.
Concernant le langage qui est propre à chacun : nous ne sommes pas nés en parlant anglais et donc, nous avons dû automatiser ce langage pour aller au-delà des symboles et donner un sens à ce que nous disons. Comme les façons dont nous marchons, dont nous nous asseyons, aucune de ces actions n’est traitée activement. Soyons reconnaissants d’avoir un système qui nous permette d’être disponibles pour faire « autre chose ».
Accepter l’ambiguïté et l’incertitude du monde.
Ce système automatique nous permet de traiter le monde sans dépenser trop d’énergie – énergie qui n’est pas infinie. Mais parfois ce système peut échouer et les préjugés surviennent.
Nous avons passé quelques heures ensemble, et déjà, je t’ai déjà jugé en fonction de mon expérience culturelle et sociale automatique, de mes expériences passées avec des personnes qui te ressemblent, qui se comportent comme toi. Or, nous avons besoin de nous dire, en préambule : « Je ne te connais pas » pour contrer ce jugement porté automatiquement. Tout en acceptant que l’autre soit un objet ambigu. Il est, pourtant, inconcevable d’accepter cette ambiguïté pour tout le monde et, plus globalement, l’incertitude du monde qui stimule une charge cognitive telle qu’elle ne peut être admise.
Je ne veux pas ressembler à d’autres neuroscientifiques qui demandent d’avoir un esprit critique et de toujours penser contre nous-mêmes avec ce problème méta-cognitif. Parce que nous n’avons pas assez d’énergie pour cela. Mais, ici, dans le cadre d’un processus créatif : je dois lutter contre mon envie de décrire le monde comme je le vois. En quelque sorte : s’oublier soi-même. Ce qui est impossible mais nous nous devons d’essayer. Un exercice facile est de vous demander qui vous êtes et de donner naissance à une création narrative collective. J’accepte alors, réellement, d’entendre votre point de vue et de lui donner, exactement, la même place que je donne à mon interprétation de ce que vous êtes. Également, il est utile de partager des expériences, car plus nous partageons d’expériences, plus nos interprétations de qui nous sommes s’enrichissent.
Maximiser les intelligences collectives.
J’appartiens à une école de pensée qui considère que nous n’avons pas autant de volonté que nous le pensons. Nous sommes déterminés par nos expériences passées. Il est plus efficace de permettre aux autres de nous montrer comment ils voient ce que nous regardons. Il est également préférable d’enrichir le pool d’expériences que nous avons avec les expériences des autres.
La santé mentale est dépendante de la qualité des interactions que nous avons avec les autres. Et, également de notre discours sur nous-mêmes et du notre sens que nous accordons à qui nous sommes et pourquoi nous faisons les choses que nous faisons. Comment pouvons-nous créer des environnements par défaut où ce que nous voyons est complexe, où nous sommes confrontés aux limites de nos perceptions, avec la complexité des perceptions des autres. Je pense, par exemple, à l’éducation.
L’éducation est basée sur la volonté ou sur l’illusion de la volonté. Il est intéressant de se battre pour la mixité sociale : lorsque je fais l’expérience d’apprendre avec d’autres, j’apprends en quelque sorte inconsciemment, de manière très implicite, que le mot est complexe, lorsque nous parlons des langues différentes. Nous ne disons pas, oh, cela pourrait s’appeler « tasse » et « kub » (كوب) et « verre ». Je sais juste que la vérité peut être appelée différemment. Nous nous devons de réfléchir aux environnements et aux liens sociaux pour développer une pensée critique au lieu de compter sur les efforts individuels : maximiser les intelligences collectives.
La question des préjugés.
Nous découvrons nos préjugés, intérieurement : on ne peut les modifier, n’ayant pas la capacité d’entrer dans notre système propre d’habitudes du type : « Je ne vais plus fumer. Je vais méditer. Je vais faire du sport le matin. » Notre cerveau confirme la bonne idée mais la modification du comportement n’est pas activable pour autant. Quand nous sommes confrontés à la diversité des autres – et cette diversité est fabuleuse ! – nous construisons de meilleurs automatismes et la remise en question de nos préjugés est naturelle. Sans cesse, la réflexion est collective : comment construire des quartiers ? Comment réfléchir le paysage urbain ? Comment imaginons-nous les récits que nous partageons avec les autres ?
Le récit a donc une responsabilité : celle de permettre de montrer la complexité des raisons pour lesquelles les gens agissent comme ils le font. Sarah Schulman, dans son livre “Conflict is Not Abuse” – un livre étonnant sur l’empathie – nous montre que lorsque des individus nous semblent être des monstres : ils ne s’endorment pas la nuit en disant : “Je suis un bâtard” mais s’endorment en se disant : “J’ai fait de mon mieux.” Il faut reconnaître que les gens ont toujours de très bonnes raisons de croire en ce en quoi ils croient et de se comporter comme ils le croient.
Le libre désir.
Les neurosciences décryptent la volonté et le libre arbitre de nos actions, à travers nos prises de décision dans notre environnement actuel, dans la vie. Lorsque nous pensons que nous avons décidé de dire quelque chose, de nous comporter ainsi ou de bouger nos mains, le cerveau a déjà traité cette information et a pris la décision de manière très implicite, en se basant encore une fois sur notre expérience passée et non sur nos ancêtres qui nous guidaient, ou quoi que ce soit d’autres.
La détermination émane de nos expériences passées. Puis, notre conscience rationalise la décision prise. Mais, dans le cadre des neurosciences, le contexte des expériences est en laboratoire. La réalité est moins complexe : on parle de libre désir et non de libre arbitre — nous pouvons nous observer sur le point de dire quelque chose que je refuse de dire. Mon enfant de sept ans, par exemple, veut dire beaucoup et pourtant il s’arrête. Nous ressentons, toutes et tous, une sorte de volonté contre nous-mêmes. Mais, il ne faut pas tomber dans l’illusion que c’est un travail en continu mais plutôt qui nécessite une grande énergie et la volonté d’accepter que nous avons tort, or nous sommes plus attachés au sentiment de cohérence. Les algorithmes des médias sociaux construisent des bulles de filtres, dans lesquelles nous sommes confortés, où il nous est donné de découvrir ce que l’on sait et aime déjà. Et nous sommes amenés à dire « Je ne comprends pas les gens qui… » En pensant qu’ils ont la volonté de décider à nouveau de leurs décisions et de leurs actions mais ils vivent, eux-même, en réalité dans la même nature de bulle qui confirme intégralement leurs idées et perceptions.
Se soucier de soi pour s’ouvrir aux autres ?
L’effort peut aussi s’accompagner de plaisir. Comme les enfants qui jouent après l’école, parfois deux heures durant alors qu’ils se sentent trop fatigués pour aller faire quelques courses ! Nos capacités sont calibrées au niveau de difficulté de la tâche à effectuer.
Écrire fatigue, voire épuise et il est agréable de finaliser son récit : une sorte d’états orgasmiques dans lesquels nous vivons. Le travail opéré sur nous-mêmes pour activer cet « amour universel » se déploie dans une certaine autonomie et peut avoir un écueil : celui de moins nous soucier justement de ce qui se passe réellement autour de nous : jugé trop violent. La sphère du développement personnel est celle qui parle le moins des guerres et de l’adversité dans le monde parce qu’elle veut être protégée puisque trop sensible. Un comportement prosocial ou obsessionnel, nombrilisme ?
L’inspiration est une connexion constante.
Une question très similaire a été abordée dans une lettre adressée à Rainer Maria Rilke. Il nous dit, pour débloquer l’évolution d’un personnage, nous nous devons de vivre, visiter des villes, tomber amoureux, rencontrer… Oublier le blocage et vivre pleinement, en ayant confiance en notre votre cerveau qui se nourrira, pendant ce temps, pour définir des pistes. Dostoïevski était une personne très sociable. Il rencontrait, discutait de ses personnages. L’inspiration émane du réseau de connexions de notre cerveau qui stocke ces échanges, ces expériences. Le cerveau établit des connexions pendant que nous dormons, pendant que nous souffrons et ainsi de suite. Il s’agit en fait d’apprendre et de désapprendre sans même que nous en soyons conscients. L’inspiration est une véritable recette de cuisine. Avec les épices !
Confronter les perceptions.
Dans le domaine des soins comme dans le journalisme, la politique, le storytelling, se pose la question : dois-je ressentir la douleur, connaître la douleur pour en parler ? Dans le journalisme, on évoque le « kilomètre mortel ». La façon, dans le récit, dont la description est définie est inhérente à la problématique de la perception. On peut aussi parler de regard colonial. Je ne sais pas si vous avez vu « The Crown », la dernière saison avec des personnages arabes représentés de manière très biaisée : « Nous sommes des gens simples, nous voulons seulement que les occidentaux nous aiment. » Mais du côté arabe, l’interrogation : « Hé, pourquoi sommes-nous toujours peints de cette façon ? » Et les Asiatiques indiquent la même chose, à propos de la façon dont ils sont représentés d’une manière très biaisée et très simpliste.
Alors, faut-il être arabe et asiatique pour pouvoir raconter une histoire impartiale ? Encore une fois, la question est : puis-je me sentir légitime pour décrire ou parler de la douleur ou des joies de certaines personnes si je les perçois comme un groupe, comme des dispositions et non aussi complexes que ma propre perception de moi-même et de mon propre groupe ? Ma réponse est simple : aller là-bas, rencontrer, échanger sur ce qu’ils pensent de votre regard. Et là, la narration collective devient également intéressante. Nous, êtres humains, ne vivons pas 400 ans, le temps qui me reste pour comprendre et appréhender la complexité est très limité. Il est donc intéressant de s’ouvrir réellement aux autres pour partager nos regards, laisser l’autre décrire — puisque l’on a ce biais d’empathie, laisser l’autre interagir et en quelque sorte valider ou non nos perceptions/préjugés.
Appréhender la complexité de chaque personnage.
Il y a un piège dans lequel l’auteur peut tomber. Il souhaite souvent inclure des personnages – aussi nombreux que divers – dans la narration et s’initie, alors, une certaine caricature. Montrer un personnage dans sa complexité est précieux. Il s’agit d’être humble quant à la mesure dans laquelle surmonter son propre point de vue et d’être nombreux à en parler au lieu d’insulter la complexité des groupes qui les représentent. Il y a notamment, souvent cet ami noir, qui est toujours là mais qui n’est pas le personnage principal et qui est toujours gentil et drôle… Le cliché ! Donc, soit rester et ne pas avoir l’intention de créer une narration diversifiée alors que vous n’êtes pas réellement capable de vraiment appréhender cette complexité. Ouvrez l’histoire à la pensée que vous ne comprenez pas !

Jan Schomburg
« Avant de lâcher-prise dans le récit, nous nous devons construire de petites rivières, dans lesquelles nous pouvons ensuite nous écouler. »
Le lâcher-prise.
Pour moi, qui suis écrivain, il faut, en effet, être dans un flux. À un moment donné, il faut lâcher-prise : se donner à l’« univers », en étant en connexion. Mais avant de lâcher-prise dans le récit, nous nous devons construire de petites rivières, dans lesquelles nous pouvons ensuite nous écouler. La pensée de Bartleby est importante : à la fois, se permettre de regarder d’en haut et également d’être à l’intérieur, en même temps, pendant l’écriture.
Vous parlez d’arts martiaux, je prends de mon côté de la Ritaline : un médicament me permettant de me concentrer. J’aimerais être en désaccord, avec joie et véhémence, sur l’idée que d’entrer dans cette méta-perspective coûte beaucoup d’énergie. Certaines personnes ont cette capacité innée et d’autres l’ont apprise. Ce n’est pas forcément un effort.
Des histoires collectives.
Ce dont je rêve, c’est d’une narration structurée, qui ne soit pas liée au protagoniste. Je travaille et réfléchit à cela depuis des années. Et c’est vraiment difficile de trouver un moyen de le faire. Comment raconter des histoires de façon collective ? Et je ne parle pas de raconter une histoire collective comme celle d’un protagoniste. Je parle de changer structurellement la façon de raconter.
Un récit est une idée.
Il peut exister, en effet, une mauvaise narration, avec des personnages superficiels. Comme si je faisais maintenant, par exemple, un film de Spike Lee où seuls les Blancs joueraient les personnages noirs dans le Queens. Nous avons par exemple, réalisé avec ma femme : un film sur Stefan Zweig. Mon grand-père était SS. Je ne suis pas juif. Ma femme n’est pas juive. Mais je pense que nous avions une très bonne idée de ce qu’est l’exil et de ce que cela signifie. Nous racontons une histoire sur l’Europe, mais elle se déroulait en Amérique du Sud. Je pense que nous en avions une bonne idée. C’était une idée précise à propos de ce personnage. Ensuite, vous pouvez raconter, en tant que petit-enfant d’un officier SS, l’histoire d’un réfugié juif. Mais il faut une bonne idée, je pense et non une mauvaise narration.

Tamara Russell
« L’attention est le principal véhicule de la façon dont nous vivons le monde. »
Désapprendre pour ouvrir le récit.
L’expression qui me vient à l’esprit est « désapprendre ». Et cela ne signifie pas qu’il faut jeter l’apprentissage par la fenêtre, mais il s’agit de reconnaître que, dans nos parcours d’apprentissage, depuis les grands yeux écarquillés d’un enfant canalisé vers la société, le statut, l’éducation, la carrière, l’expertise, la tribu : il y a un rétrécissement qui rend les choses plus efficaces. Et, en grandissant, nous tirons parti de l’automatisme.
Mais peut-être arrivons-nous à un certain moment dans notre vie où nous réalisons que désapprendre va porter plus de fruits. Et c’est peut-être à ce moment-là, que la pleine conscience basée sur des moyens d’essayer d’ouvrir la pensée, d’enrichir les banques de mémoire avec de nouvelles informations et de maintenir une conscience de l’altérité. Le cerveau est vraiment génial et nous aide à maintenir nos postures dites naturelles ou automatiques. La question est : « Comment puis-je maintenir cette conscience de mon corps, faire en sorte que ces informations corporelles circulent dans mon cerveau, permettre à ma prise de décision et à mon processus créatif de s’appuyer sur toutes les sources d’information ? ».
Emprunter des chemins non balisés.
Nous devons être vigilant à « Je sais ». Dès que je pense que « je sais » : nous devons prêter attention, sans forcément rejeter ces choses que « je sais ». Une voie neuronale s’ouvre instantanément et se prépare à s’activer — douce, profonde et facile. Or, il pourrait y avoir quelque chose de plus fructueux si, je prends ma machette et que je m’engage sur un chemin non balisé.
Notre flux de pensées, chaque seconde, suit son cours et nous n’en sommes pas conscients. Nous avons l’opportunité de créer, proactivement, la dyade du sujet et de l’objet, en tant qu’homo sapiens sapiens. La relation se crée et les options possibles se définissent. Nous sommes capables de critiquer cette pensée et de la déclarer fausse, par exemple. C’est une thérapie cognitivo-comportementale. Restructurer nos pensées avec méthode d’argumentation. Par opposition à un mode plus compatissant. Être conscient de ces pensées est un effort, en étant alertes et, surtout, détendus nous permettant de nous questionner : « Mon esprit divague : n’est-ce pas intéressant ? ».
L’abandon de soi, dans le récit.
Je rebondis à l’idée que c’est un luxe de pouvoir entraîner son cerveau : si je veux que mon esprit soit alerte, il doit être détendu, tout comme mon corps, alerte, détendu. Nous avons différentes manières de nous entraîner à la pleine conscience. Nous le faisons tous les jours, dans chaque action : à la Bruce Lee ! Faire les courses, enfiler une veste. Que ce soit pour une mère qui travaille beaucoup, un professionnel de la santé, une personne en crise psychotique.
La mobilisation de l’énergie – de mon point de vue – est à rapprocher des arts martiaux. On évoquait le moment où l’on s’abandonne en quelque sorte à l’univers. Avec notamment le Qi Gong, qui est l’aspect le plus curatif et énergétique des arts martiaux, avec deux types différents de chi (énergies) : son propre chi pour guérir et un autre type de chi s’apparentant à une canalisation, se retirer de l’équation : retirer le moi égoïque de l’équation pour s’ouvrir au chi universel. Le cosmos opère la guérison et l’humain n’est qu’un véhicule. La question est d’identifier le rôle de la reddition, de l’abandon.
Mieux se connaître pour se connecter à l’autre.
La pratique de la pleine conscience me permet de me rencontrer, certes et m’aide dans la connexion à l’autre avec l’approfondissement des micro-moments de partages avec un chauffeur de bus, un commerçant, un membre de la famille… Les types de résilience et de robustesse acquis nous apprennent à connaître nos propres réactions émotionnelles et augmentent notre sensibilité à ce que vivent les autres. La capacité de vivre avec la douleur ou même la terreur est maximisée en dialoguant, en résolvant des problèmes, en partageant des histoires.
Prêter attention pour vivre le monde.
En quoi un personnage pourrait être différent en fonction de sa capacité à prêter attention ? Les personnes atteintes de troubles de l’attention vivent et interagissent avec le monde, appréhendent l’apprentissage, les relations, les émotions d’une manière différente. Pour les natifs du numérique, on parle notamment des effets de la technologie sur l’altération de l’attention. Ma conviction est que l’attention est le principal véhicule de la façon dont nous vivons le monde : nous devons la valoriser, la protéger pour ne pas la commercialiser ou que d’autres puissent en tirer profit. Notre dernier cadeau le plus précieux pour nos enfants est l’attention, de haute qualité, dans le moment présent, sans jugement, qui a finalement pour fondement : le soin. Être présent. Ressentir, sentir, réagir. C’est la pleine conscience.

Thomas Roze
« Il existe des similitudes entre ostéopathie et arts martiaux, notamment via la pression du pied du patient ou encore la sensation de son équilibre, de notre propre équilibre. Tout est une question de disponibilité de réception aux sensations. »
Faire expérience pour ressentir.
La principale difficulté, pour moi, dans mon quotidien est de gérer mes propres perceptions de ce que me partage le patient et de ce que je ressens, notamment avec mes mains. Je me dois de faire des allers-retours entre ce que je ressens vraiment ou ce que je souhaite ressentir ? Cette perception est-elle différente de ce que vit le patient ? Par exemple, la définition du degré de la douleur. Nous avons beaucoup d’échelles afin de graduer la douleur et nous permettre, ainsi, d’identifier facilement quelle maladie ou quel traumatisme peut causer de la douleur. Il s’agit surtout de la souffrance, de l’expérience que vit le patient. Et il est parfois difficile de garder l’objectivité par rapport à ce que ressent le patient.
Lorsque j’ai mal moi-même, je suis bien mieux placé pour comprendre la douleur du patient. Lorsque cela fait longtemps que je n’ai plus de douleur, il m’est beaucoup plus difficile de percevoir l’effet de la douleur sur le patient. J’en ai récemment parlé avec ma femme qui est sage-femme. Elle m’expliquait le fait qu’au sein de ses collègues, avoir accouché avait complètement changé la façon de prendre en charge la patiente. En faire l’expérience permet, plus facilement, de gérer l’empathie et de bien comprendre ce que vit le patient.
Concernant l’empathie justement, je pense que parfois, lorsque le patient ressent de la douleur ou a un problème, on essaie de l’aider en s’aidant soi-même. C’’est en effet moi que j’essaie de réconforter et d’apaiser lorsque j’essaie de calmer la douleur du patient. Comme si l’empathie était un égoïsme, ce qui serait assez difficile pour moi à concevoir, mais je peux y faire face. Je pense plutôt à une certaine réciprocité : j’aide mon patient pour m’aider moi-même.
Partager, en duo, pour guérir.
Je dois mettre mes perceptions notamment via mes mains, dans le point de vue des patients. Je dois ressentir les choses avec le patient pour lui faire comprendre aussi qu’il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ce qui est remarquable est – quand on touche le corps, une zone en particulier, le patient commence à parler de cette zone, ce qu’il n’a pas fait pendant la partie interrogatoire de la consultation. Il n’en était pas conscient. Mon investigation est en duo : c’est toujours un flux mutuel que nous devons nourrir, dans la relation avec le patient. Par exemple, via la modulation du son de ma voix, je perçois que le patient peut commencer à se détendre et les mouvements deviennent plus fluides.
Il existe des similitudes avec les arts martiaux, notamment via la pression du pied du patient ou encore la sensation de son équilibre, de notre propre équilibre. Tout est une question de disponibilité de réception aux sensations. Il est important d’aller plus profondément dans le corps en termes de perception : s’évader en termes de processus intellectuel et de devenir simplement les véritables sentiments et sensations, hors les préoccupations du quotidien.